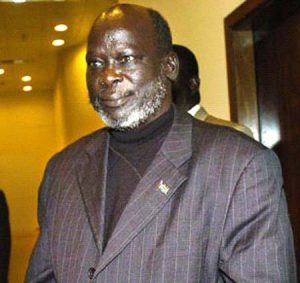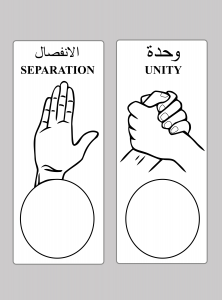Il y a cinq ans, s’amorçait en Tunisie des mouvements de protestation qui allaient s’étendre à plusieurs pays arabes : Égypte, Libye, Yémen, Bahreïn et Syrie. Des journalistes français étaient sur place. Quels regards ont-ils porté sur ces mouvements ?
L’appellation « Printemps arabes » désigne l’ensemble des manifestations et mouvements vécus par une partie des pays arabes de fin 2010 à mi 2012. Les revendications sont multiples : plus de liberté, de démocratie, de pouvoir d’achat, et moins de corruption. L’origine de ces mouvements remonte à décembre 2010 en Tunisie. À ce moment là, le peuple descend dans les rues pour s’élever contre le président Ben Ali.
Le déclencheur
Le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s’immole par le feu à Ben Arous, en Tunisie. Sa marchandise a été confisquée par les autorités. Le même mois, des manifestations éclatent pour protester, de manière pacifique, contre Ben Ali. Le 12 janvier 2011, celui-ci quitte le pouvoir. De véritables soulèvements populaires traversent les pays voisins. En Égypte, les opposants politiques se mobilisent, place Tahrir, contre le président Hosni Moubarak. En moins de quinze jours, celui-ci démissionne. Ces deux pays vivent alors une période de transition démocratique. Pour d’autres, les « Printemps arabes » ont été très différents.
La révolte s’étend
En Libye, la contestation débute le 15 février 2011, sur les mêmes bases que les révoltes tunisienne et égyptienne. Violemment réprimée, celle-ci tourne au conflit armé. Fin août 2011, une offensive internationale, menée notamment par la France et le Royaume-Uni, intervient sur le sol Libyen et reprend Tripoli. À ce moment-là, le général Mouammar Kadhafi prend la fuite avant d’être finalement rattrapé, torturé et exécuté le 20 octobre 2011.
En Syrie, quelques jours après la chute des présidents tunisien et égyptien, la contestation démarre à son tour contre le président Bachar el-Assad. Elle est aussi brutalement contenue par le régime, et débouche sur une guerre civile. Celle-ci est toujours en cours, et ses conséquences sont désastreuses pour la population. Environ cinq millions de Syriens ont fui et 465 000 personnes sont mortes ou ont disparu. Au Yémen, les contestations apparaissent le 27 janvier 2011. Elles aboutissent à des affrontements armés qui s’achèvent le 25 février avec le départ du président Ali Abdallah Saleh. Pour autant, la transition démocratique est un échec, le pays traverse actuellement une guerre civile ( http://prixbayeux2017.infocomlannion.fr/yemen-guerre-oubliee-mediatisee/ )
Le 14 février 2011, Bahreïn connaît aussi une vague de protestations pacifiques durement stoppée par le régime.

Pas de ligne éditoriale ?
« Le reportage international se débarrasse des lignes éditoriales » , affirme Jenna Le Bras, journaliste free-lance pour Libération et Le Figaro. Comment des médias aux lignes éditoriales très différentes ont-il traités les révoltes qui ont secoué le monde arabe dès 2011 ?
Pour la reporter, le traitement est sensiblement le même, c’est davantage l’actualité du pays que la direction éditoriale du journal qui influe sur le traitement. « Je traite de la même façon l’actualité que ce soit pour Le Figaro ou pour Libération. Sur ma manière de faire, c’est la même chose », poursuit la journaliste. Avant d’ajouter avec une moue perplexe : « Il y a quand même quelques subtilités. Par exemple, pour Le Figaro, je vais davantage évoquer les violences faites contre les chrétiens. Après, il ne faut pas oublier les grands patrons de presse qui jouent un rôle dans le contenu éditorial.»
Vincent Hugeux, grand reporter à l’Express, indique :
« En réalité, il peut y avoir au niveau de la rédaction un présupposé idéologique mais lorsque nous sommes envoyés spéciaux, on est les maîtres. Mais, dans le cas d’un hypothétique financement de Sarkozy pour la Libye, Le Figaro va mettre la pédale douce alors que médias de gauche vont davantage insister sur cette affaire. Mais là, on est plus dans le commentaire, moins dans le reportage. »
A l’image du quotidien Le Monde qui titrait en 2011 : « La révolte des abeilles contre les frelons », le peuple est présenté comme courageux, ou en lutte pour la démocratie. « Il y a une sympathie spontanée pour les moments insurrectionnels de la part des médias. Pour des raisons culturelles, les journalistes ont tendance à accorder du crédit à la sincérité de ces soulèvements, surtout lorsqu’ils s’opposent à un régime tyrannique. Les “contestataires” ne sont pas souvent des combattants. Ce sont des professeurs, des maçons ou encore, des chercheurs. Ce qui attire l’empathie du lecteur » , confirme le journaliste de l’Express.
Un avis partagé par Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne en charge des « Printemps arabes » en Syrie, en Égypte, en Turquie et au Liban pour Libération, l’Express ou encore Télérama. « Il y a une légère différence de traitement mais la ligne éditoriale est moins sensible lors d’actualités internationales. Il y a parfois des angles plus adaptés au lectorat. L’Express par exemple est lu par beaucoup de cadres, j’angle davantage sur l’actualité économique.»
Les réseaux sociaux, un rôle surestimé ?
Grand nombre des titres de presse française ont insisté sur l’importance des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter dans les mouvements de révolte. Le journal Les Échos parle même en 2011 de « révolution Facebook ». Pour la chercheure en information et communication Lina Zakhour, spécialiste du discours, la formulation est erronée. « Évidemment que Facebook a joué un rôle, mais on ne peut résumer la révolution à cela. Facebook est un agrégateur d’opinion rapide mais, même sans cet outil, la révolution aurait eu lieu. A Beyrouth en 2005, il n’y avait pas Facebook mais les citoyens ont trouvé d’autres moyens pour contester l’ordre établi.» Cette expression est pourtant reprise par un grand nombre de médias.
Une couverture différente
La Tunisie est le pays où le « Printemps arabe » et la transition démocratique semblent avoir abouties. Le spécialiste du Moyen-Orient et professeur à Sciences Po Paris, Frédéric Encel met en avant la proximité de la Tunisie avec l’Occident et la France pour comprendre cette réussite : « Un élément de réponse peut être la très forte présence d’une diaspora tunisienne importante et assez impliquée dans la vie politique des États européens et notamment de la France. Ce n’est qu’une variable mais il n’y a pas une raison qui fait qu’à l’évidence ça a fonctionné pour la Tunisie ». Cela pourrait aussi expliquer le traitement médiatique de certains quotidiens nationaux français où ce pays est perçu comme la « vitrine démocratique des pays arabes ».
La révolution libyenne, quant à elle, se situe à l’opposé de la révolution tunisienne. Les conflits Libyen et Syriens sont marqués, eux, par une guerre civile et l’intervention militaire d’une coalition internationale sur leur propre sols. Or, bien que partageant des similarités, leur traitement médiatique diffèrent. Parce que selon Vincent Hugeux, quand le pays du média est impliqué dans le conflit, le traitement médiatique est plus empathique.

Menaces et difficultés d’accès
Les entraves à l’exercice journalistiques peuvent exister sous plusieurs formes :
« Depuis 2013, le gouvernement de Sissi orchestre une chasse aux journalistes soupçonnés d’être proches des Frères musulmans, ainsi qu’une « sissi-isation » des médias. Un arsenal juridique répressif menace de plus en plus la liberté de la presse. Adoptée en août 2015, la loi anti-terroriste impose aux journalistes de respecter la version officielle lors des couvertures des attentats au nom de la sécurité nationale ; l’adoption de la loi sur la régulation des médias fin décembre 2016 fait également craindre un contrôle accru du pouvoir exécutif sur la presse et les médias. Une grande partie de la région du Sinaï est interdite aux journalistes et défenseurs des droits humains », indique Reporters Sans Frontières (RSF).
Jenna Le Bras, journaliste freelance basée au Caire, explique les conditions d’exercice du journalisme en Egypte et la manière de les contourner :
« Les journalistes étrangers sont plus protégés, il y a la barrière de la langue. Nous écrivons en anglais et français, les autorités ne nous comprennent pas et il n’y a pas de contrôle en amont. Une loi de 2015 interdit aux journalistes de contredire les autorités officielles. Il faut donc contourner les communiqués du gouvernement qui relaient souvent de fausses informations.»
Leïla Minano, journaliste indépendante du collectif Youpress, a elle aussi connu des difficultés en Égypte :
En Libye, depuis la chute du général Kadhafi, l’accès au terrain est plus compliqué. En effet, les journalistes sont confrontés à de multiples agressions des forces armées, et à celles du groupe État islamique. Vincent Hugeux souligne l’importance du fixeur dans ces situations : « La mouvance islamique radicale représente un autre facteur de désordre. Il est nécessaire d’être en compagnie d’un fixeur de confiance qui sait garder son sang-froid et a une connaissance du terrain infaillible.»
« Printemps arabes »
« Renaissance », « renouveau » ou encore « second souffle », telles sont les images associées à l’expression « Printemps arabe ». Dénuée de toute analyse géopolitique, celle-ci est apparue dans les médias français dès 2011.
Elle fait, pour certains, référence aux printemps des peuples de 1848 ou aux événements de Prague. Pour d’autres, il s’agit simplement d’un cliché qui ne correspond pas aux révoltes vécues par les pays arabes. « Un printemps, c’est quelque chose de beau, les médias ont été nombreux à reprendre cette expression. C’est un ensemble de termes qui suscite des émotions fortes, mais qui joue aussi sur l’imaginaire, les sentiments du lecteur », analyse Lina Zakhour.
Certains médias, tel que Le Monde Diplomatique, entourent l’expression de guillemets. Lors de son travail en Égypte, la reporter Jenna le Bras n’a, elle, jamais employé le terme de « Printemps arabe ». « Il faut faire attention aux termes que l’on emploie, je ne l’emploie pas car je pense que je ne l’ai jamais vraiment consentie. C’est un terme optimiste, je ne pense pas que son utilisation ait du sens », confie t-elle.
Un terme politique
Six ans plus tard, la vague démocratique tant attendue n’a toujours pas déferlée sur les pays concernés par les révolutions arabes. En juillet 2011, Le Point titrait : « Après le printemps arabe, l’automne arabe. » Rappelant ainsi le chaos généralisé en Libye ou encore l’instabilité politique en Syrie.
Pour Jenna Le Bras, il s’agit d’un terme politique teinté de connotations positives sur les conséquences de ces mouvements sociaux. Elle explique : « Il s’agit de mouvements très différents selon les pays. La difficulté de les qualifier provient de leur complexité. Concernant la Libye, les termes chaos ou encore anarchie sont souvent repris pour désigner la situation politique. Vu la complexité de la situation, les médias sont rares à se lancer dans des analyses géopolitiques poussées. Pour moi ce terme est inadapté car seule la Tunisie a connu un printemps.»
La difficulté de nommer ces révoltes provient de la surprise qu’elles ont provoquée en Occident. « Il y a eu un effet de surprise, au début des premières manifestations, on ne savait pas de quoi on parle pour grand nombre d’observateurs, c’était difficile de définir ce phénomène », explique Luis Martinez.
La chercheure libanaise Lina Zakhour précise : « Un média qui a de la sympathie pour le gouvernement ne va pas dire printemps, mais va considérer ce mouvement comme mauvais pour le peuple. C’est un véritable jugement de valeur ».
Tous ces éléments sont à prendre en compte pour situer le discours des journalistes lors des « Printemps arabes. »
Perrine Juan et Auriane Duroch-Barrier